Le 54 rue du Château, un rendez-vous surréaliste
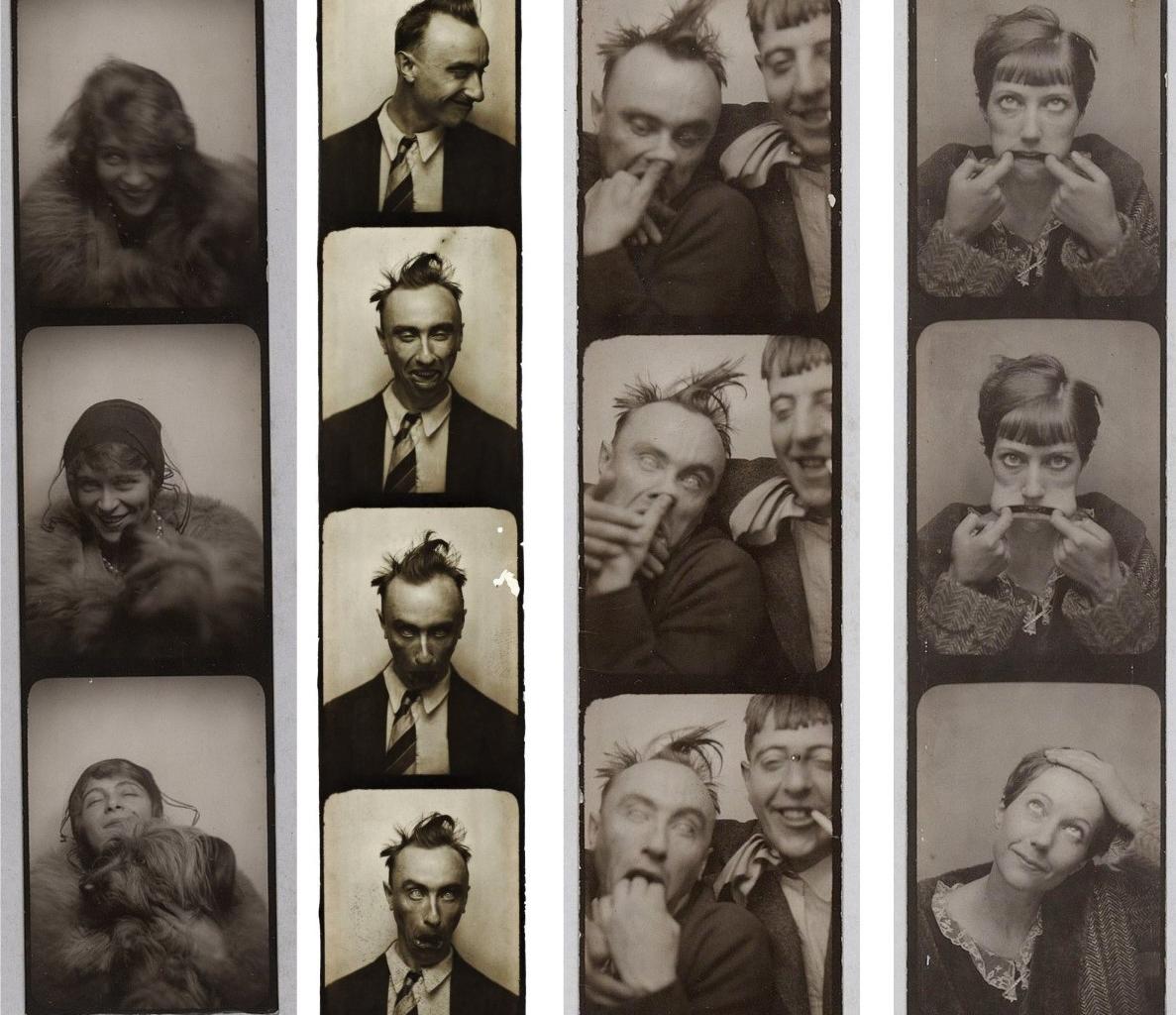
Au sein du quartier de Montparnasse, non loin de la gare, la rue du Château était autrefois le lieu de rendez-vous de nombreux artistes et intellectuels, fervents défenseurs de la libre pensée des Années folles. A l’origine de ce phalanstère : Prévert le poète, Yves Tanguy le peintre et Marcel Duhamel l’éditeur qui, aux hasards des rencontres, ont forgé un des lieux les plus déterminants de la pensée surréaliste.
Cet article est réservé aux membres Zigzag. Pour accéder à tous les articles en illimité et soutenir Paris Zigzag cliquez sur s’abonner.
S'abonner













